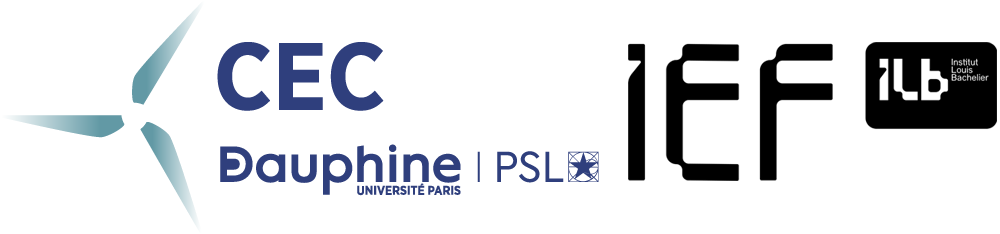Scénario : Pierre-Marie Terral, professeur d’histoire et de géographie, agrégé et docteur en histoire contemporaine de l’Université Paul-Valéry Montpellier III. Dessin : Sébastien Verdier, dessinateur et bibliographe.
Jeudi 28 octobre 1971, le souper de la famille Guiraud a un goût amer : à la télévision, le ministre de la défense nationale, Michel Debré, officialise la décision d’extension du camp militaire du Larzac. Ce camp militaire, dont l’installation avait déjà expulsé de nombreux paysans de leur terre, s’étalera de 3 à 17 000 hectares. Une centaine d’agriculteurs, dont les Guiraud, découvrent que cette extension englobe leurs fermes, et comprennent donc que l’expulsion sera inévitable. Rapidement, ces derniers créent l’Association de sauvegarde du Larzac, organise une grande manifestation à Millau, et allument au mois de février une dizaine de feux de détresse sur les corniches du causse qui surplombent la ville.
Larzac, histoire d’une résistance paysanne [i] retrace, en bande dessinée documentée, l’un des conflits fonciers les plus emblématiques de la Ve République.
Une lutte pour la terre et contre l’oubli d’un territoire
Le début de la Bande dessinée documente l’affrontement de deux conceptions bien différentes d’un territoire. D’un côté, celle de l’Etat central, pour qui le plateau du Larzac est un espace marginalisé, peu productif, et faiblement intégré aux dynamiques de développement. Ce regard technocratique, fondé sur une grille d’analyse quantitative et stratégique, entre en contradiction avec la réalité vécue par les acteurs locaux : un territoire structuré par une agriculture pastorale, porteur d’une culture enracinée. Cette disqualification territoriale repose sur une perception biaisée du plateau comme « désert de cailloux », ignorante de ses ressources sociales et écologiques. Elle révèle une dynamique bien connue en sociologie des territoires : celle de la tension entre centralisation des décisions et autonomie des espaces locaux (Raffestin, 1980).
Paysans contre militaires, l’espace public comme terrain d’affrontement
Tenté dans un premier temps de revendiquer fusils à la main leur droit à la terre, les agriculteurs du Larzac vont très vite s’abandonner à une autre forme de résistance : la non-violence, inspiré par le jeune de Lanza del Vasto (créateur de la communauté de l’arche) en soutien aux paysans. Quelques jours plus tard, 103 des 107 agriculteurs concernés par l’extension du camp font le serment de ne jamais vendre leurs terres, et font peu à peu exister leur lutte au sein de l’espace public. Théorisé par Jurgen Habermas, l’espace public est d’une part, la sphère sociale où la communication entre les citoyens produit l’opinion publique, et d’autre part, la sphère sociale au sein de laquelle les citoyens peuvent se constituer en force politique, capable d’exercer une influence sur l’État. Ainsi, dès 1972 naissent des comités du Larzac dans tout le pays afin d’ouvrir le soutien et de populariser le mouvement. Les 10 ans de lutte seront marqués par des actions publiques d’envergures, des montées de tracteur vers la capitale, au pâturage de brebis tatouées du célèbre « Gardarem Lo Larzac » * sous la Tour. Le Larzac est ainsi l’enseignement d’une lutte d’occupation : des terres dans un premier temps, de l’espace public dans un second.
Une résistance locale hétérogène
Loin d’être homogène, la contestation du Larzac repose sur la convergence d’acteurs aux profils, idéologies et pratiques diverses : paysans catholiques conservateurs, militants syndicalistes (notamment ceux des Paysans Travailleurs **), objecteurs de conscience, écologistes, anarchistes, communautés spirituelles issues de la non-violence active. La Bande dessinée revient avec humour et finesse sur ces interactions entre prêtres et soixante-huitards : si l’habit ne fait pas le moine, le sans habit ne l’étonne pas moins.
Le Larzac, laboratoire écologique et social
Le mouvement donne naissance à un laboratoire de transformation sociale, enraciné dans l’expérience quotidienne d’une lutte prolongée. Au sud du causse, la ferme du Cun devient un centre de recherche sur la non-violence, dirigé par Hervé Ott. On y conçoit une stratégie militante fondée sur l’action constructive : « Si l’on revendique quelque chose, on commence à le réaliser nous-mêmes ». Cette philosophie transforme la résistance en expérimentation sociale, et élargit la boîte à outils de l’action militante.
La lutte engendre également une refondation foncière et d’organisation agricole coopérative. Un groupement foncier agricole (GFA) est créé dès la fin de l’année 1973, outil de gestion collective destinée à acheter des parcelles stratégiques, verrouillant la progression des acquisitions de l’armée. En multipliant les souscripteurs de parts d’un montant d’une centaine de francs, les paysans renforcent leur assise foncière et financière et complexifient la procédure d’expropriation tout en constituant un réseau de militants désormais liés au plateau par leur acte de propriété. En 1985, après l’abandon officiel du projet par François Mitterrand, est créée la Société civile des terres du Larzac, structure autogérée. Elle prolonge l’œuvre du GFA, mais sur une échelle plus globale : il ne s’agit pas seulement de protéger la terre, mais d’en faire un bien commun, transmis à des paysans locataires, dans une logique de justice spatiale et de souveraineté alimentaire. Ce modèle unique a permis, dès les années 1980, de développer l’agriculture biologique, les circuits courts, la diversification des cultures, et l’installation de jeunes agriculteurs.
L’intérêt pour les luttes présentes et à venir
L’expérience du Larzac constitue aujourd’hui un répertoire d’action réactivé par de nombreuses luttes partout dans le monde. Dès le sommet de Stockholm en 1972, l’agronome René Dubos formulait une maxime devenue centrale : « Penser global, agir local ». Cette articulation entre enjeux mondiaux (militarisation, accaparement des terres, libéralisation de l’agriculture) et ancrage territorial est au cœur de l’héritage larzacien. L’auteur termine son ouvrage en citant le sociologue Manuel Cervera-Marzal, qui à propos de la « génération climat », souligne la nécessité d’une transmission intergénérationnelle des pratiques de lutte : « Ces jeunes ne sont pas les premiers ; ils ont besoin d’une transmission de savoir-faire et d’expérience ». Le Larzac en constitue l’un des jalons fondateurs : il démontre la capacité d’un territoire marginalisé à devenir le foyer d’innovations politiques et sociales durables, dans un contexte de conflit et d’injustice.
Quel prix pour le Larzac ?
La bande dessinée Larzac, histoire d’une résistance paysanne illustre un point mort majeur de l’économie de l’environnement : sa difficulté à intégrer les dimensions sociales, historiques et territoriales. Dans ce récit, la valeur attribuée à la terre dépasse très largement les seuls critères économiques – rendement, utilité, prix – pour s’ancrer dans un rapport symbolique, identitaire et politique à l’espace. Pour reciter Claude Raffestin (1980), le territoire n’est pas une donnée naturelle mais un produit social, issu d’un processus de médiation entre acteurs, ressources et représentations. Or, les approches classiques de l’économie environnementale, notamment néoclassiques, réduisent souvent le territoire à une variable spatiale neutre, susceptible d’être optimisée, aménagée ou compensée selon une logique d’équilibre. Ce réductionnisme a été vivement critiqué par des chercheurs comme Joan Martinez-Alier (2002), dans L’écologisme des pauvres, qui montre comment les populations rurales, souvent défavorisées par les politiques de développement, défendent des territoires non pas pour leur valeur d’échange, mais pour leur valeur d’usage, leur ancrage historique et leur signification culturelle. Le conflit du Larzac illustre précisément cette dynamique : les paysans ne refusent pas l’extension militaire au nom d’un simple calcul coût-bénéfice, mais au nom d’un droit à la terre, d’une histoire paysanne et d’une logique de subsistance enracinée.
Lire Larzac, histoire d’une résistance paysanne, à l’aube d’un projet autoroutier controversé (jugé anachronique par la communauté scientifique), et qui plus est sur des terres occitanes, offre un bol d’optimisme.
Marin Guinard – doctorant CEC.
- * “Nous garderons le Larzac”
- ** Mouvement créé dans les années 70 par Bernard Lambert, syndicaliste et militant paysan, en réaction à l’industrialisation de l’agriculture et à la domination des grandes exploitations.
[i] Terral, P-M. (auteur), Verdier, S. (illustrateur), Larzac, histoire d’une résistance paysanne, Ed. DARGAUD, Mars 2024, pp. 176.