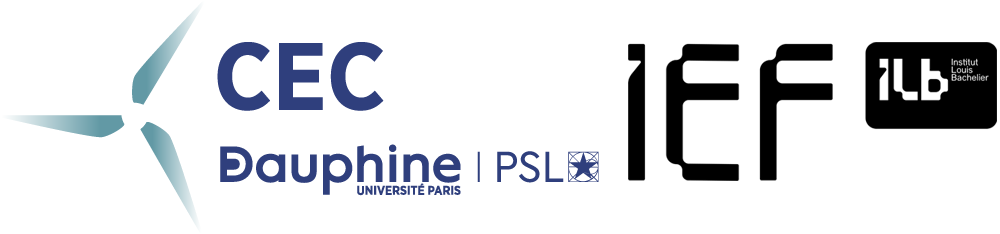Eric Posner est Professeur de droit à l’Université de Chicago et membre de l’Académie américaine des arts et des sciences. Ses recherches portent sur la législation antitrust, la réglementation financière, le droit international et le droit constitutionnel.
Glen Weyl a fondé le projet spécial de Microsoft Research « Plural Technology Collaboratory » et en dirige la recherche. Il est également le fondateur de la fondation RadicalxChange et le fondateur et président du Plurality Institute.
L’orthodoxie économique qui gouverne l’Occident s’effrite. Inégalités croissantes, concentration des entreprises, stagnation des salaires : notre capitalisme est-il encore viable ? Eric Posner et Glen Weyl proposent dans leur livre de 2018, Radical Markets : Uprooting Capitalism and Democracy for a Just Society [i], une réponse surprenante : plutôt que d’abandonner les marchés, il faut les étendre à de nouveaux domaines.
Le diagnostic : une crise multiforme Aux États-Unis, la part du travail dans la valeur ajoutée diminue depuis plus de 40 ans. La concurrence s’est dramatiquement réduite, permettant aux corporations d’extraire des profits excessifs. Les promesses du « ruissellement économique » ont échoué. Pour les auteurs, ces dysfonctionnements proviennent d’un problème : les marchés ne sont pas assez libres et développés. Que ce soit pour les possessions de la vie courante, les données utilisateurs de nos activités en ligne, notre système politique ou l’immigration, les auteurs proposent de créer ou d’améliorer les systèmes de marché pour révolutionner le fonctionnement de nos sociétés.
La propriété comme monopole Les auteurs établissent un parallèle avec la crise britannique du XIXe siècle. Entre 1750 et 1850, la propriété foncière concentrée entravait l’industrialisation. Henry George proposa alors une taxe sur la valeur inutilisée des terres pour favoriser leur usage productif. La terre est en effet un bien particulier car en quantité limitée, et dont la propriété privée exclusive peut mener à des allocations très peu efficaces (spéculation, opposition à des projets d’intérêt commun…). Pour les auteurs c’est en fait le cas de pratiquement toutes nos possessions, qui sont souvent utilisées bien en deçà de leur potentiel économique. Ils proposent le système COST (Common Ownership Self-Assessed Tax) : chaque personne déclare la valeur de ses biens et paie des taxes au pro rata de la valeur déclarée, mais n’importe qui peut acheter ces actifs au prix déclaré. Ce système force l’honnêteté : déclarer trop bas expose au rachat forcé, déclarer trop haut coûte cher en taxes. Fini la sécurité absolue sur ses biens, mais un système qui favorise l’usage productif des actifs.
Le vote quadratique Le système « une personne, une voix » échoue à mesurer l’intensité des préférences. Quelqu’un de passionné a le même pouvoir qu’une personne indifférente. Le « vote quadratique » que proposent Posner et Weyl repose sur une idée simple : chaque votant disposerait d’un nombre de crédits qu’il peut dépenser pour voter pour les candidats de son choix, ou des mesures en particulier. Pour éviter la « tyrannie de la majorité », les problèmes de vote stratégique et d’achat d’influence le coût en crédits de chaque vote supplémentaire pour une même mesure serait quadratique : un vote coûte un crédit, deux votes quatre crédits, trois votes neuf crédits, etc. Cette structure empêche les riches de dominer toutes les décisions et force chacun à prioriser ses combats. Le Colorado a testé ce système avec succès.
Les migrations comme marché Quand un Mexicain traverse la frontière vers les États-Unis, son salaire augmente de plus de 200%. Ouvrir les frontières pourrait doubler le PIB mondial. Les auteurs proposent un système de parrainage : n’importe quel citoyen pourrait parrainer un migrant et recevoir une portion de ses revenus en échange d’aide à l’intégration. Cela créerait un marché privé alignant les intérêts des natifs et des immigrants.
Démanteler les monopoles modernes Les géants tech dominent leurs marchés. Le problème selon les auteurs ? La « propriété commune » : quand BlackRock, Vanguard et State Street détiennent des parts dans des entreprises concurrentes d’un même secteur, ces dernières ont moins d’incitations à se faire concurrence. Cette propriété institutionnelle est passée de 4% dans les années 80 à presque 30% aujourd’hui. Leur proposition est d’interdire la propriété commune de plusieurs entreprises majeures d’un même secteur d’activité. Cela réduirait les incitations à la collusion implicite et augmenterait la compétition entre firmes, donc le rapport qualité prix final pour les consommateurs.
Les données comme travail L’IA dépend des données générées par nos activités : recherches, posts, achats. Cette contribution n’est pas rémunérée. Les auteurs proposent de reconnaître cette contribution comme du travail méritant rémunération, avec des collectifs de « travailleurs de données » négociant avec les géants tech. Dans ce système, les algorithmes d’IA rémunèreraient les utilisateurs selon la valeur économique marginale que leurs données donnent à l’IA sur le marché. Cela permettrait une redistribution de la « rente informationnelle » des géants de la Tech vers les consommateurs.
Critique et conclusions L’approche des auteurs est intellectuellement ambitieuse mais soulève plusieurs questions. Les mécanismes de marché peuvent-ils prendre en compte les valeurs sociales au-delà de l’efficacité ? Le système COST créerait des disruptions significatives. Vivre sous la menace constante qu’autrui achète nos possessions ne créerait-il pas une anxiété intolérable ?Le vote quadratique représente un changement fondamental par rapport aux principes démocratiques d’égalité politique. La proposition migratoire soulève des questions sur la marchandisation des relations humaines. Plus fondamentalement, cette vision requiert un confort sociétal avec l’instabilité économique qui peut être irréaliste. Réévaluation constante des valeurs, prix fluctuants, marchés perpétuels : beaucoup valorisent la stabilité plus que l’efficacité maximale. C’est un angle mort de la philosophie libérale qui ne considère que les individus, pas les structures sociales. Aucun sociologue n’est cité, renforçant l’idée selon laquelle les auteurs, malgré leur volonté affichée de n’être catégorisé « ni de droite ni de gauche » ont en réalité un parti pris. Il faut cependant nuancer cette lecture européiste, les auteurs étant états-uniens, un pays ou la dichotomie gauche/droite se définit différemment qu’en Europe.
Peut-être la plus grande contribution du livre est-elle d’élargir notre imagination sur ce que les marchés pourraient être. Les auteurs nous rappellent que les institutions économiques sont des créations humaines qu’on peut redessiner. Leur vision défie le faux choix entre fondamentalisme de marché et populisme anti-marché, offrant un point de départ provocateur pour repenser notre avenir économique.
Ange Blanchard – doctorant CEC.
[i] Posner, E., Weyl, G. , , Ed. Princeton University Press, Mai 2018, pp. 368.